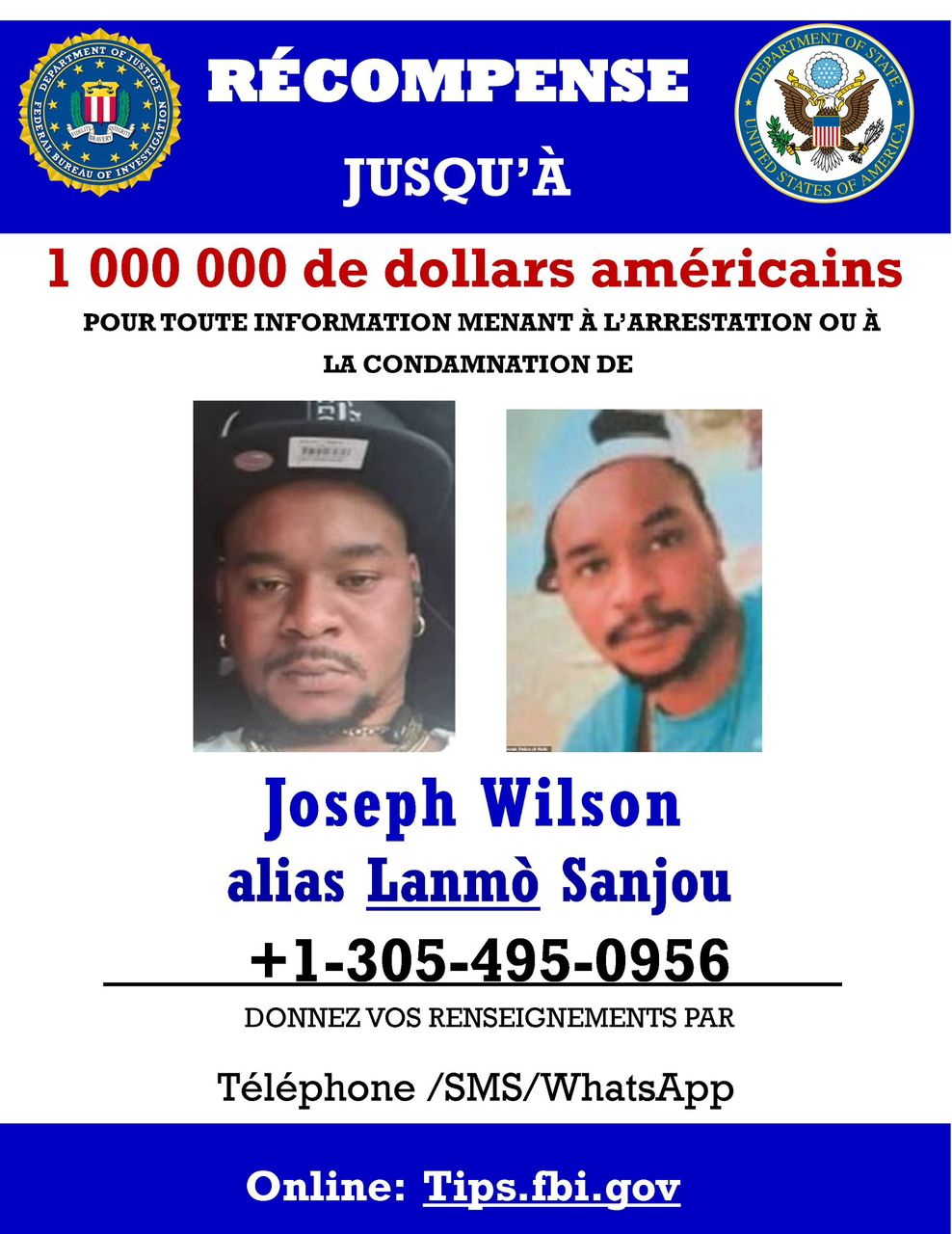Par Pierre Josué Agénor Cadet
Alors que la « dette de l’indépendance » imposée par la France à Haïti en 1825 revient avec insistance dans le débat public, à l’heure où les voix se multiplient pour réclamer réparation, justice et reconnaissance historique, le professeur Pierre Josué Agénor Cadet revient avec rigueur et clarté sur un pan fondamental de notre mémoire collective. À travers cette analyse fouillée, il remet en perspective le bicentenaire de l’acceptation de l’ordonnance de Charles X par le gouvernement haïtien, le 11 juillet 1825, en dénonçant les approximations historiques et en rappelant la violence économique et symbolique de cette « rançon » de l’indépendance
Le 11 juillet 2025 marque le bicentenaire d’un acte historique aux conséquences profondes pour Haïti : l’acceptation par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer de l’ordonnance de 1825 émise par Charles X, roi de France et de Navarre. Ce texte conditionnait la reconnaissance de l’indépendance du gouvernement de la partie française de Saint-Domingue (ou l’indépendance d’Haïti) à une indemnité faramineuse de 150 millions de francs or, ramenée en 1838 sous le règne de Louis-Philippe Ier à 90 millions, à verser aux anciens colons français. Deux siècles plus tard, cette date symbolise encore l’humiliation politique, économique, sociale et diplomatique imposée à la première République noire du Nouveau Monde.
Le Conseil présidentiel de transition (CPT) et le gouvernement dirigé par M. Didier Fils-Aimé ont commémoré avec faste, le 17 avril 2025 dernier, ce qu’ils ont présenté comme le bicentenaire de l’ordonnance de 1825, acte par lequel la France reconnaissait l’indépendance de la colonie de Saint-Domingue, devenue Haïti, en échange d’une indemnité exorbitante.
Cependant, cette célébration officielle est entachée d’une confusion historique majeure. Comme l’a justement souligné le professeur historien Dr Watson Denis dans un article publié le mardi 8 juillet dans le prestigieux quotidien Le Nouvelliste, sous le titre : « 8 juillet 1825 – 8 juillet 2025 : Remémoration du bicentenaire de l’acceptation de l’ordonnance du roi Charles X par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer », Dr Denis admet, à juste titre, que la date du 17 avril ne correspond pas à l’acceptation formelle de l’ordonnance par Haïti, mais plutôt à sa promulgation en France.
La réalité historique est encore plus nuancée : l’ordonnance royale fut signée à Paris le 17 avril 1825, mais elle ne fut connue, reçue et surtout acceptée et mise officiellement en vigueur que le 11 juillet 1825.
Ainsi, commémorer le bicentenaire de l’ordonnance le 17 avril ou le 8 juillet constitue une erreur de perspective historique. Cela témoigne soit d’une négligence, soit d’une méconnaissance des faits, et souligne l’importance d’une rigueur scientifique lorsqu’il s’agit de rappeler les événements fondateurs.
La vérité historique ne souffre d’aucune approximation : elle se fonde sur les documents, les archives, et l’analyse critique des sources orales, écrites, audiovisuelles et muettes. C’est pourquoi il importe de chercher la vérité pour dissiper cette confusion et replacer la commémoration du bicentenaire de l’ordonnance dans son véritable contexte historique.
Le 3 juillet 1825, une flottille de guerre française comprenant sept corvettes et douze navires, commandée par le baron de Mackau, mouille dans la baie de Port-au-Prince. Elle est porteuse de l’ordonnance du roi Charles X reconnaissant l’indépendance d’Haïti (bien que l’ordonnance mentionne l’indépendance du gouvernement de la partie française de Saint-Domingue) aux conditions suivantes :
Ouverture de tous les ports de Saint-Domingue au commerce avec toutes les nations ;
Droits de douane égaux pour tous, à l’exception de la France qui bénéficiera du demi-tarif douanier ;
Versement de 150 millions de francs en dédommagement des colons dépossédés, en cinq annuités consécutives (la première échéant au 31 décembre 1825).
Le président Boyer forme une commission composée du secrétaire général Joseph Balthazar Inginac, du sénateur Pierre-Prosper Rouanez et du colonel Marie Elizabeth Eustache Frémont pour discuter de l’ordonnance avec le baron de Mackau. Cette commission nationale, formée des représentants du gouvernement, du parlement et de l’armée, rejette l’ordonnance pour deux principales raisons : le montant de l’indemnité, représentant environ dix fois le budget national, dépasse les capacités du pays ; et les termes de l’ordonnance sont jugés offensants pour la dignité nationale de la jeune République.
Le baron de Mackau sollicite alors une audience privée avec le président Boyer. Celui-ci prend l’engagement de faire accepter l’ordonnance par le peuple haïtien. En souscrivant à cette humiliation imposée par la France, le président Jean-Pierre Boyer a non seulement révélé l’impuissance de la diplomatie haïtienne, mais a également hypothéqué le présent et l’avenir de la Nation haïtienne.
Après cette rencontre, le baron de Mackau est accueilli au Sénat le 11 juillet 1825 par son président, le sénateur Gayot, pour la séance de ratification. Ce jour-là, le sénateur Rouanez donne lecture de l’ordonnance, qui est rapidement votée et adoptée à l’unanimité par les treize sénateurs présents.
Après cette ratification, le cortège se dirige vers le Palais national. Le baron de Mackau est introduit dans la salle des Généraux où se trouvent le président Boyer et les membres de son gouvernement. Après avoir reçu l’ordonnance royale des mains du sénateur Daumec, le président Boyer prononce un discours marquant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, auquel répond le baron de Mackau. Tandis que le vaisseau amiral L’Eglau entame une salve de 21 coups de canon en l’honneur du pavillon national, les autres navires de l’escadre, totalisant 528 canons, tirent également.
À son tour, le Fort Alexandre salue le pavillon royal de France par une salve de 21 coups, suivi par tous les autres forts de la capitale et par les garde-côtes ancrés dans la rade.
Après cette première partie de la cérémonie officielle au Palais, les officiers français et haïtiens se rendent à l’église paroissiale où un Te Deum d’action de grâce est entonné. Une réception offerte dans la soirée, dans la maison nouvellement achevée du secrétaire d’État Imbert, située rue Républicaine (Grand’Rue), met fin aux activités de la journée.
La date du 8 juillet 1825 constitue la date d’acceptation de fait ou protocolaire de l’ordonnance. En effet, c’est ce jour-là que la frégate française La Circé, commandée par le baron de Mackau, débarque au port de Port-au-Prince avec l’ordonnance signée par Charles X, exigeant qu’Haïti accepte ses conditions dans un délai de cinq jours.
Cependant, l’acceptation officielle, par la publication d’un acte gouvernemental haïtien, n’intervient que le 11 juillet 1825. Cette divergence de dates s’explique par le processus administratif interne au gouvernement de Boyer, qui, bien que soumis à un ultimatum, préfère laisser passer quelques jours avant de formaliser sa décision. Le 8 juillet est donc la date du choc diplomatique ; le 11 juillet est celle de l’acte politique.
L’acceptation et l’application de cette ordonnance ont eu de lourdes et graves conséquences sur Haïti. La rançon de l’indépendance a constitué un véritable pillage légal de l’État haïtien, orchestré par une puissance coloniale revancharde. Le paiement de l’indemnité a duré plus de soixante-dix ans, entre 1825 et 1883, accaparant jusqu’à 80 % des revenus de l’État à certaines périodes. L’impact sur le développement du pays a été considérable : absence d’investissements publics, désorganisation des finances, stagnation économique et affaiblissement institutionnel.
Les démarches pour une restitution répondent à une nécessité de justice historique et à un besoin de réparation sociale. Depuis le début du XXIe siècle, plusieurs voix, en Haïti comme dans la diaspora, réclament la restitution de cette rançon. Ces démarches prennent diverses formes : recherches historiques, revendications, demande de réparation et de restitution formulée par le président Aristide dans un discours officiel le 7 avril 2003, campagnes de sensibilisation d’ONG, d’artistes, de personnalités politiques françaises, de membres de la diaspora haïtienne, d’intellectuels et de militants internationaux menant campagne à travers le monde pour faire connaître et dénoncer cette injustice.
Jusqu’à présent, les autorités françaises parlent de « dette morale » mais excluent toute reconnaissance juridique des torts infligés à Haïti en lui imposant, sous fortes menaces, une rançon de l’indépendance.
Cependant, des juristes internationaux et des défenseurs des droits humains estiment que la demande haïtienne est légitime selon le droit international, notamment dans le cadre des réparations post-coloniales et des pratiques économiques coercitives. C’est peut-être ce qui a conduit l’Assemblée nationale française à approuver, le jeudi 12 juin 2025, une proposition de résolution appelant à étudier le processus de restitution de ce qu’elle considère comme une « double dette » imposée à Haïti.
Deux cents ans après l’acceptation officielle et l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 1825, Haïti porte encore les stigmates d’une extorsion déguisée en acte diplomatique. Cette remémoration ne doit pas être une simple évocation du passé, mais un appel à la justice historique, à la mémoire active et à la mobilisation pour une Haïti réconciliée avec son droit à la dignité et à la souveraineté.
Professeur Pierre Josué Agénor Cadet, Ancien ministre de l’éducation nationale
Références bibliographiques :
Cadet, Pierre Josué Agénor, Haïti/France : La rançon de l’indépendance, Port-au-Prince, Haïti, Pro Éditions, août 2024.
Cadet, Pierre Josué Agénor, Histoire et vérité, réflexions sur quelques tranches du passé d’Haïti, C3 Éditions, Imprimerie Brutus, 2017.
Cadet, Pierre Josué Agénor, Haïti, le prix d’un bicentenaire, La Presse Évangélique, 2006.
Castor, Suzy, L’indemnité de 1825 : conséquences politiques et économiques, Port-au-Prince, Haïti, CRESFED, 1995.
Corvington, Georges, Port-au-Prince au cours des ans, tome II, Port-au-Prince, Haïti, Éditions Henri Deschamps, 1975.
Denis, Watson, « 8 juillet 1825 – 8 juillet 2025 : Remémoration de l’ordonnance de Charles X par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer », Le Nouvelliste, 8 juillet 2025.
Madiou, Thomas, Histoire d’Haïti, tome V, Port-au-Prince, Haïti, Imprimerie Smith, 1848.
Trouillot, Hénock, Réflexions sur l’indépendance haïtienne, Port-au-Prince, Haïti, Éditions Henri Deschamps, 1974.
Archives nationales d’Haïti. Fonds présidentiels : correspondance officielle de Jean-Pierre Boyer, 1825.
Archives diplomatiques françaises. Ministère des Affaires étrangères, série Amériques, dossier Haïti, 1825.