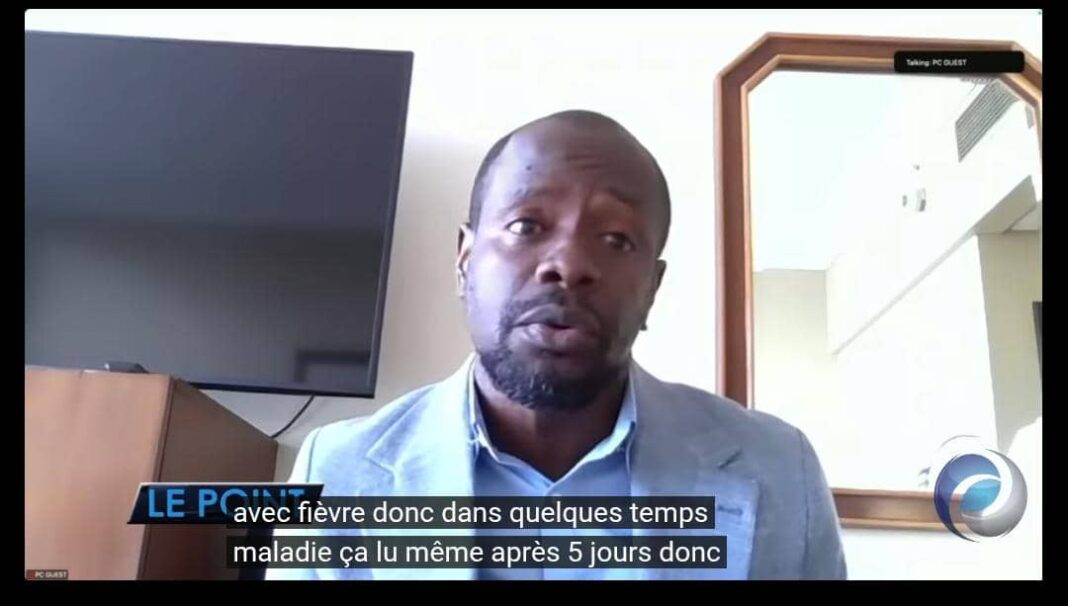Par Jean Wesley Pierre
Le président américain Donald Trump a présenté ce lundi 29 septembre 2025, à la Maison-Blanche un plan de paix en 20 points visant à mettre fin à près de deux années de conflit à Gaza. À ses côtés, le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a exprimé un soutien prudent, conditionnant l’application de l’accord à l’attitude du Hamas, qu’il accuse d’être seul responsable de la poursuite des hostilités.
Cette initiative, qui combine promesses de cessez-le-feu, libération d’otages et création d’une autorité de transition à Gaza, survient dans un contexte de fatigue internationale face à un conflit qui a déjà fait plus de 66 000 morts côté palestinien, majoritairement des civils selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, validés par l’ONU, et 1 219 morts côté israélien, en majorité civils, depuis l’attaque du 7 octobre 2023 que Benjamin Nétanyahou s’efforce de nous rappeler.
Le document rendu public par la Maison-Blanche contient cinq axes, prévoyant:
- Un cessez-le-feu immédiat et un retrait progressif des forces israéliennes.
- La libération des otages israéliens dans les 72 heures suivant l’aval de Tel-Aviv, en échange de la libération par Israël de plus de 1 000 prisonniers palestiniens, dont plusieurs centaines condamnés à perpétuité.
- La création d’une autorité temporaire “technocratique et apolitique”, excluant le Hamas et l’Autorité palestinienne, pour administrer le territoire.
- Le déploiement d’une Force internationale de stabilisation (ISF) sous supervision américaine et arabe.
- Une amnistie pour les membres du Hamas qui déposeraient les armes ou choisiraient l’exil.
Dans une concession notable par rapport à ses déclarations passées, Donald Trump a assuré que « personne ne sera forcé de quitter Gaza », s’éloignant ainsi de ses propos antérieurs évoquant une possible évacuation de la population palestinienne. Il a promis de « donner l’occasion de construire un Gaza meilleur ».
Benjamin Nétanyahou, critiqué par de nombreux experts et militants pour les droits de l’homme, a salué une initiative qui, selon lui, « permet d’atteindre les objectifs de guerre », à savoir la démilitarisation de Gaza, le désarmement du Hamas et le retour des otages. Mais le chef du gouvernement israélien a immédiatement fixé des lignes rouges :
« Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s’ils disent l’accepter mais le bloquent, Israël terminera le travail », a-t-il averti, laissant clairement entendre que la « génocide » ne fera que commencer.
Le Premier ministre a également exclu tout rôle de l’Autorité palestinienne à Gaza « sans transformation radicale », réaffirmant son opposition constante à la création d’un État palestinien, contrairement au souhait de nombreux gazaouis.
Fidèle à son discours égocentrique, à son style flamboyant, Donald Trump, président des États-Unis a qualifié ce lundi de « peut-être l’un des plus beaux jours de la civilisation », espérant une réponse « positive » du Hamas tout en promettant un soutien « total » à Israël en cas de rejet malgré la forte volonté du reste du monde de se désolidariser avec Israël dans l’exécution de son plan macabre dans l’extermination des gazaouis.
« Dans quelques jours, il ne devrait plus y avoir de tirs à Gaza… Peut-être pour l’éternité. Ne serait-ce pas agréable ? », a-t-il lancé, multipliant les superlatifs.
Le président américain, en pleine campagne électorale, s’est également efforcé de flatter son allié israélien :« Netanyahou est un guerrier… Israël a de la chance de l’avoir. »
Ces déclarations, ponctuées de références bibliques par Nétanyahou (« ceux qui te béniront seront bénis »), visent à séduire à la fois l’électorat évangélique américain, acquis à la cause israélienne, et une opinion israélienne lassée d’une guerre coûteuse.
Si le plan américain a été salué par le Forum des familles d’otages israéliens comme « historique », son application reste incertaine. Le Hamas, seul interlocuteur encore capable de négocier la libération des captifs, n’a pas encore répondu officiellement.
Plusieurs analystes notent que l’exclusion de l’autorité palestinienne et la supervision directe du président américain, Donald Trump, allié fidèle de l’Israël, pourraient compliquer l’adhésion des pays arabes modérés, tout en renforçant l’image d’un processus imposé par Washington.
Par ailleurs, l’idée d’une force internationale à Gaza suscite de nombreuses questions : Quels pays y participeront ? Quelle sera sa légitimité ? Et comment éviter que sa mission ne soit perçue comme une nouvelle occupation ?
Au-delà des annonces, le plan américain entérine de facto un rapport de force largement favorable à Israël. Il ne prévoit ni reconnaissance de l’autodétermination palestinienne ni garanties pour un État palestinien futur.
En insistant sur le maintien temporaire d’une présence militaire israélienne à Gaza, il valide l’idée d’une sécurité dictée par Tel-Aviv. Cette logique risque d’alimenter le ressentiment dans le monde arabe et d’affaiblir les voix palestiniennes modérées, déjà fragilisées par des années de blocus et de divisions internes.
Pour Donald Trump, ce plan apparaît aussi comme une opération de politique intérieure. En s’érigeant en « faiseur de paix » tout en promettant un soutien illimité à Israël, il cherche à séduire simultanément l’électorat évangélique, pro-israélien, et les électeurs fatigués des guerres interminables au Moyen-Orient. L’insistance sur la libération des otages, thème émotionnel fort, s’inscrit dans cette stratégie : Donner l’impression d’un président capable de résultats rapides, même au prix d’un accord bancal.
Pour le Hamas, l’alternative est délicate : accepter un plan qui l’exclut de l’avenir politique de Gaza ou refuser et risquer une offensive militaire encore plus dévastatrice. Une acceptation pourrait être perçue comme une reddition, mais un refus offrirait à Israël et à Washington le prétexte d’une escalade justifiée au nom de la sécurité. Cette position d’encerclement, où chaque choix comporte un coût énorme, illustre l’impasse dans laquelle se trouve le mouvement islamiste après deux années de guerre.
Enfin, les critiques soulignent que cette proposition, malgré ses promesses de cessez-le-feu, évite soigneusement la question centrale : l’occupation et le statut des territoires palestiniens. En mettant l’accent sur la démilitarisation et l’amnistie, mais sans perspective politique claire, Washington et Tel-Aviv parient sur une « Paix de gestion » plutôt qu’une Paix de justice. Or, l’histoire récente de Camp David à Oslo montre que les accords qui ne s’attaquent pas aux causes profondes ne font que repousser l’inévitable retour de la violence.
Le plan Trump-Nétanyahou apparaît comme la proposition la plus détaillée depuis le déclenchement du conflit, mais il repose sur une équation fragile : convaincre le Hamas de céder sans contrepartie politique majeure, tout en satisfaisant un Israël qui refuse l’idée d’un État palestinien.
Dans l’immédiat, les familles d’otages, palestiniens et israéliens, attendent des gestes concrets. Pour l’heure, l’espoir d’un cessez-le-feu repose sur une question simple mais explosive : Le Hamas acceptera-t-il de négocier avec un Donald Trump qui promet à Israël son « soutien total » en cas d’échec ?