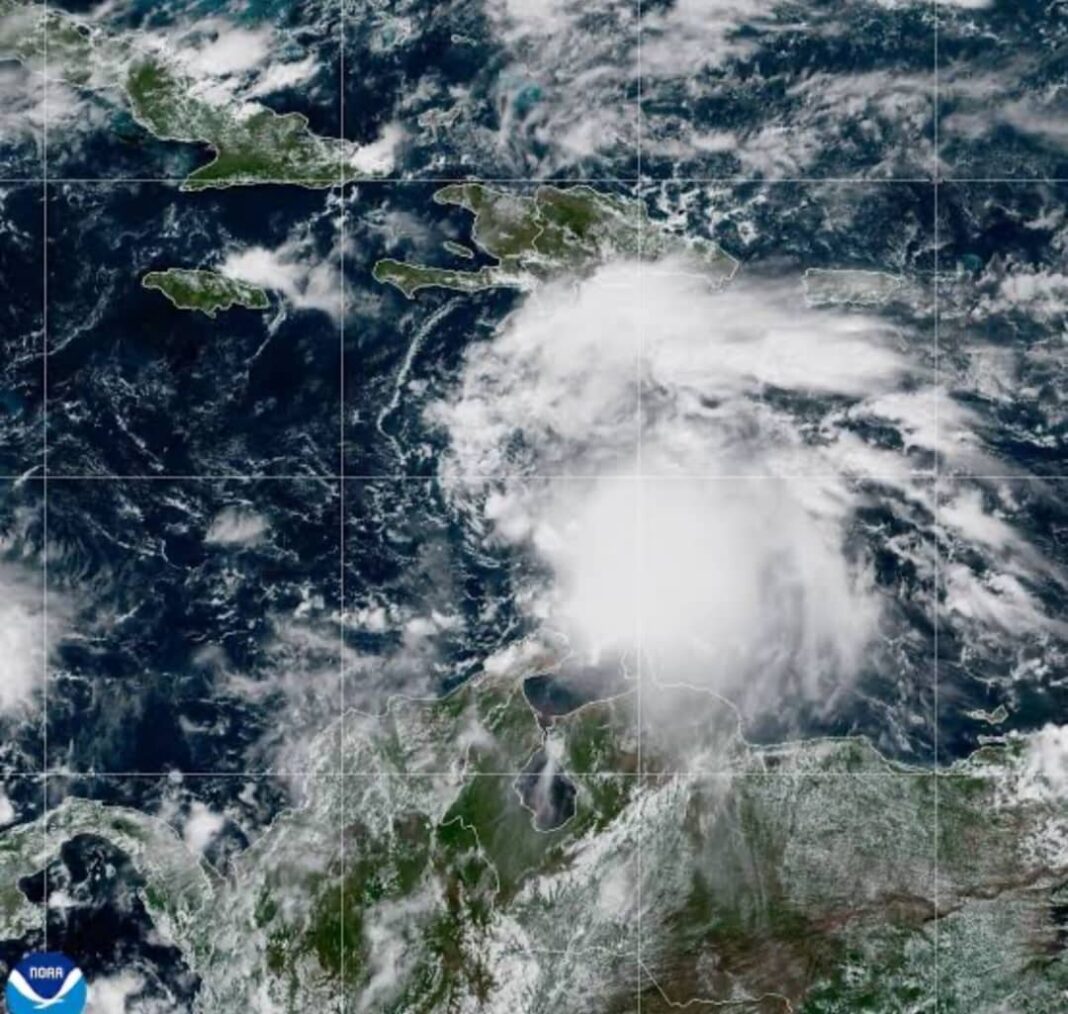(À propos du document du professeur Wilson Laleau : « Transitions politiques et changement de la Constitution – Nous avons tout faux »)
Depuis près de quarante ans, Haïti évolue dans un état d’exception permanent. Chaque crise annonce une transition, chaque transition promet une refondation, et chaque refondation, inévitablement, ramène au point de départ. Cette circularité politique a transformé la transition en régime et l’instabilité en normalité. Pourtant, cette répétition n’est pas le fruit d’un hasard historique, mais d’une méthode – ou plutôt, d’une absence de méthode.
C’est précisément cette faille que met en lumière le texte du professeur Wilson Laleau, Transitions politiques et changement de la Constitution : nous avons tout faux (2025). L’auteur y propose une lecture à la fois historique, institutionnelle et pragmatique du blocage politique haïtien. Il avance une hypothèse audacieuse : le problème d’Haïti ne réside pas dans la nature de ses constitutions, mais dans la manière dont elles sont conçues, adoptées et appliquées. Autrement dit, le mal est procédural avant d’être textuel.
- De la répétition des crises à la crise de la répétition
Depuis 1986, la succession de gouvernements provisoires, de chartes transitoires et de promesses constitutionnelles a produit un modèle politique singulier : celui d’une transition perpétuelle. Ce phénomène, déjà identifié par Pierre-Raymond Dumas comme une “transition devenue régime en soi”, traduit la difficulté de l’État haïtien à passer du provisoire au permanent.
Le professeur Laleau revisite cette dynamique en s’appuyant sur des travaux majeurs de la science politique contemporaine — Robert Fatton (Haiti’s Predatory Republic, 2002), Michel-Rolph Trouillot, Douglass North, Barry Weingast, Acemoglu et Robinson — pour montrer que la répétition des crises est le produit d’un cercle vicieux associant faiblesse institutionnelle, hypercentralisation, capture oligarchique et dépendance externe.
Selon cette grille d’analyse, les transitions haïtiennes échouent parce qu’elles se contentent d’une reconstruction juridique sans transformation institutionnelle. L’État se redéfinit par la loi, mais ne se réinvente pas par la pratique. Les constitutions se succèdent, mais les structures de gouvernance — partis, collectivités, administration publique, justice, contrôle citoyen — demeurent embryonnaires ou instrumentalisées.
- Le piège du formalisme constitutionnel
La critique que formule Wilson Laleau rejoint les constats de North et Weingast (1989) : les institutions politiques ne produisent de stabilité que lorsqu’elles reposent sur un équilibre crédible entre acteurs, fondé sur la confiance et la contrainte mutuelle. En Haïti, chaque Constitution a échoué non par son contenu, mais par l’absence de légitimité de son environnement politique.
Ainsi, la Constitution de 1987 — la plus durable de l’histoire nationale — portait les germes d’un État décentralisé et pluraliste, mais sans que soient créés les organes destinés à la faire vivre (Cour constitutionnelle, Conseil électoral permanent, fonction publique méritocratique, collectivités autonomes). La façade républicaine a été maintenue, mais la charpente institutionnelle est demeurée fragile.
Ce formalisme constitutionnel a produit un paradoxe : plus la norme est proclamée, moins elle est appliquée. Le professeur Laleau observe que le débat haïtien se polarise entre les tenants de l’application stricte de la Constitution de 1987 et ceux qui appellent à une refonte totale, sans que soit interrogée la question essentielle : dans quel contexte institutionnel et social une Constitution peut-elle exister ?
- Pour un processus constitutionnel expérimental : la transition construite
Face à cette impasse, l’auteur propose une innovation conceptuelle : la transition construite.
Il s’agit de transformer la transition — généralement subie — en un processus d’apprentissage collectif, conçu comme un laboratoire constitutionnel.
Ce laboratoire se déroulerait sur une période limitée (cinq ans) et comprendrait trois phases successives :
- La stabilisation politique, avec la désignation d’un président custode et la formation d’un gouvernement de coalition élargi, garant de la neutralité institutionnelle et de la continuité de l’État.
- L’expérimentation institutionnelle, fondée sur la mise en place de gouverneurs départementaux, d’assemblées de maires et de comités citoyens de suivi, afin de tester les mécanismes de décentralisation et de reddition de comptes.
- La conférence nationale constitutionnelle, chargée de rédiger une Constitution définitive à partir des leçons tirées de cette expérimentation, en intégrant les ajustements nécessaires issus de l’observation empirique.
Cette démarche s’inspire du pragmatisme institutionnaliste (Evans, 1995 ; Acemoglu et Robinson, 2012), selon lequel la stabilité politique se construit par l’expérimentation, l’évaluation et l’apprentissage, plutôt que par la seule promulgation de normes. Monsieur Laleau invite ainsi à rompre avec le réflexe de la rupture – propre aux transitions subies – pour instaurer une méthode d’apprentissage politique fondée sur la participation et l’évaluation continue.
- Le lien indissociable entre refondation politique et mutation économique
L’un des apports les plus significatifs du texte du professeur Laleau est de replacer la question constitutionnelle dans une perspective économique. L’auteur établit un lien direct entre structure institutionnelle et structure productive : un État prédateur génère une économie de rente ; un État coopératif engendre une économie solidaire.
S’inspirant de la tradition du développement institutionnaliste (Evans, North, World Bank 2023), il plaide pour une transition économique parallèle à la transition politique : passer d’un État prédateur à un capitalisme coopératif, fondé sur les communes, les coopératives départementales et la mobilisation de la diaspora.
Cette proposition réhabilite la dimension territoriale du développement, longtemps marginalisée par la centralisation port-au-princienne. En plaçant les communes au cœur de la production et de la décision, elle vise à créer une base économique et sociale pour la gouvernance locale, condition indispensable à la légitimité politique.
- De la méthode à la maturité politique
Ce que propose le professeur Laleau, au fond, n’est pas un modèle constitutionnel, mais une méthode de refondation.
Dans une société où la précipitation institutionnelle a souvent tenu lieu de vision, il suggère de réapprendre à gouverner le temps politique. La transition ne serait plus un intervalle d’attente, mais un moment d’expérimentation, de mémoire et de construction.
Cette approche rejoint les analyses d’Elinor Ostrom (1990) sur la gouvernance collective : les institutions durables sont celles qui permettent la co-construction de règles, l’auto-organisation et la responsabilité partagée. De la même manière, la “transition construite” selon Wilson Laleau repose sur trois principes méthodologiques :
• l’apprentissage (mesurer et ajuster),
• la participation (associer les acteurs sociaux et territoriaux),
• l’évaluation (institutionnaliser le contrôle citoyen et la redevabilité).
C’est cette méthode, et non un texte en soi, qui pourrait fonder la légitimité de la prochaine Constitution.
- Une contribution méthodologique à la pensée politique haïtienne
Le texte de Wilson Laleau se distingue par sa clarté conceptuelle et son refus du fatalisme historique. Là où d’autres diagnostics s’arrêtent au constat d’un État capturé ou d’une société civile désorganisée, il propose un cadre opérationnel pour sortir du provisoire.
Il ne s’agit plus de proclamer la fin de la transition, mais de l’instituer comme un espace de maturation politique. La véritable rupture n’est pas celle du texte, mais celle du processus : substituer à la transition subie une transition construite, encadrée, documentée, collective.
Enfin: apprendre à gouverner nos transitions, pour gouverner notre destin
En définitive, Transitions politiques et changement de la Constitution – nous avons tout faux propose une leçon de méthode et une pédagogie du changement. Dans un pays où l’urgence sert souvent d’alibi à l’improvisation, cette réflexion invite à ralentir pour mieux construire, à planifier pour mieux durer.
Haïti ne sortira pas de la transition par une nouvelle Constitution, mais par l’apprentissage institutionnel qu’elle se donnera les moyens de conduire. Passer de la transition subie à la transition construite, c’est accepter que la stabilité ne se décrète pas : elle s’apprend, se pratique, se mesure.
En cela, l’essai du professeur Wilson Laleau s’inscrit dans la tradition des penseurs pragmatiques du politique. Il ne décrit pas seulement une impasse : il trace une voie.
Et cette voie, en Haïti comme ailleurs, commence par une conviction simple — mais révolutionnaire : pour refonder la République, il faut d’abord refonder la manière de la construire.
Emmanuel Jean François