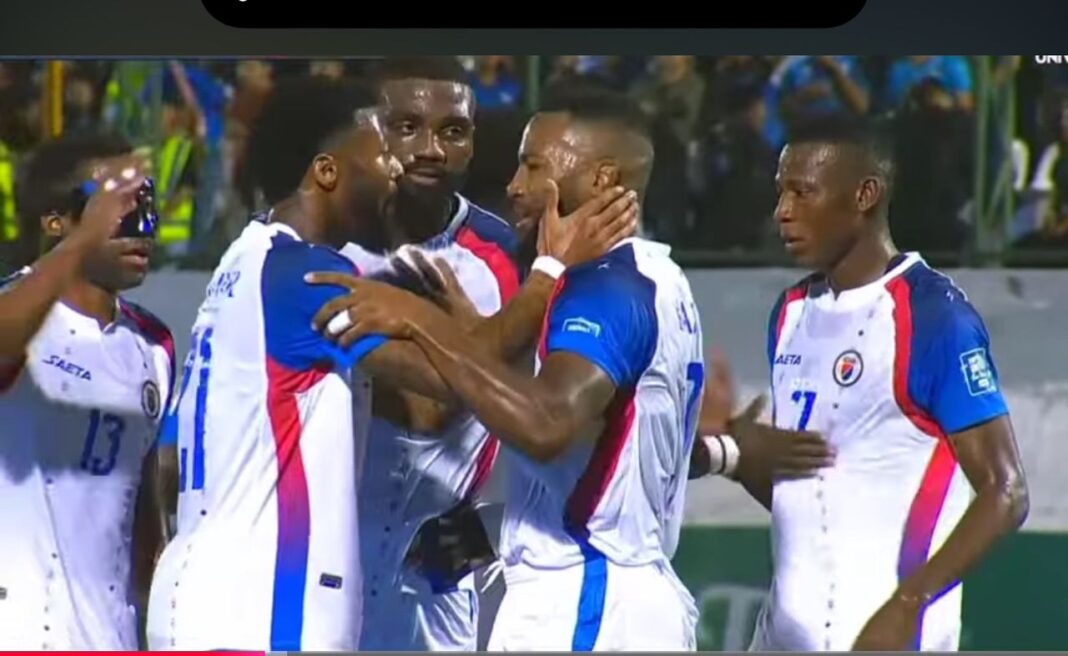Par Jean Venel Casséus
Ces deux dernières années, en tant que poète et parolier, j’ai réalisé trois albums musicaux en me servant de l’intelligence artificielle : Haïti, maux pour mots, La Poétique du Jazz et Haïti on the Beat. Ces œuvres ont bouleversé ma conception de la création. J’y ai vu naître une forme de précision presque inhumaine : des harmonies d’une justesse mathématique, des textures d’une beauté infaillible, des atmosphères d’une profondeur que seuls les génies savaient autrefois atteindre. Tout y est parfait, tout y est bien calculé. Sous les mélodies générées par l’intelligence artificielle, mes textes ont gagné en densité, en sensibilité, mais surtout en audience, même auprès de ceux que la poésie ne touche pas d’ordinaire. C’est la magie de la musique : elle fait entendre ce que les mots seuls ne suffisent pas à dire.
En savourant ces œuvres, j’ai compris qu’il y avait là une profession en jeu : celle de musicien. En jeu, parce que ces professionnels, s’ils ne retournent pas à l’essence de leur art, risquent de s’effacer dans le sillage de leurs propres outils. L’intelligence artificielle a déjà conquis le monde de la musique enregistrée. À travers ses applications génératives accessibles sur un simple téléphone, elle compose, elle arrange, elle orchestre. Elle simule le souffle, imite la main, reproduit la justesse. Il suffit à celui qui la manie d’un peu de goût et de curiosité pour séduire les oreilles les plus averties. La technique, hier domaine du savoir, est aujourd’hui domaine de l’algorithme.
Mais pas de fatalisme, car depuis toujours le vrai théâtre du musicien est la scène, sa scène. Sa gloire, son honneur et son éternité résident dans le vivant de ses performances, qu’elles se déploient dans un concert, un festival, un carnaval, une rue ou à l’angle d’un trottoir. C’est là qu’il retrouve sa nature : un être de souffle et de feu, non de formule et de code. L’histoire de la musique ne s’est jamais écrite dans le silence des studios, mais dans la ferveur des foules, dans la vibration du présent. Le musicien n’est pas né pour enregistrer le son, mais pour affronter le monde.
Sur scène, le son n’est plus un produit, il est un acte. Il ne vise pas la mémoire, mais la présence. Le concert ne reproduit rien : il recrée le monde à partir du tremblement d’un instant. La musique y redevient relation entre le geste et le regard, entre la voix et le silence, entre la fragilité du musicien et l’attention de ceux qui l’écoutent. C’est dans ce face-à-face que se joue l’avenir de son art.
Le musicien du futur ne s’opposera pas à la machine ; il la prolongera. Il portera sur scène la matière qu’elle aura créée, il lui prêtera un corps, un souffle, une mémoire. L’intelligence artificielle engendrera les sons, l’humain leur donnera un lieu. Et c’est dans cette alliance entre la perfection calculée et la présence incarnée que la musique trouvera son équilibre et le musicien son gagne-pain.
Pennsylvanie, 10 octobre