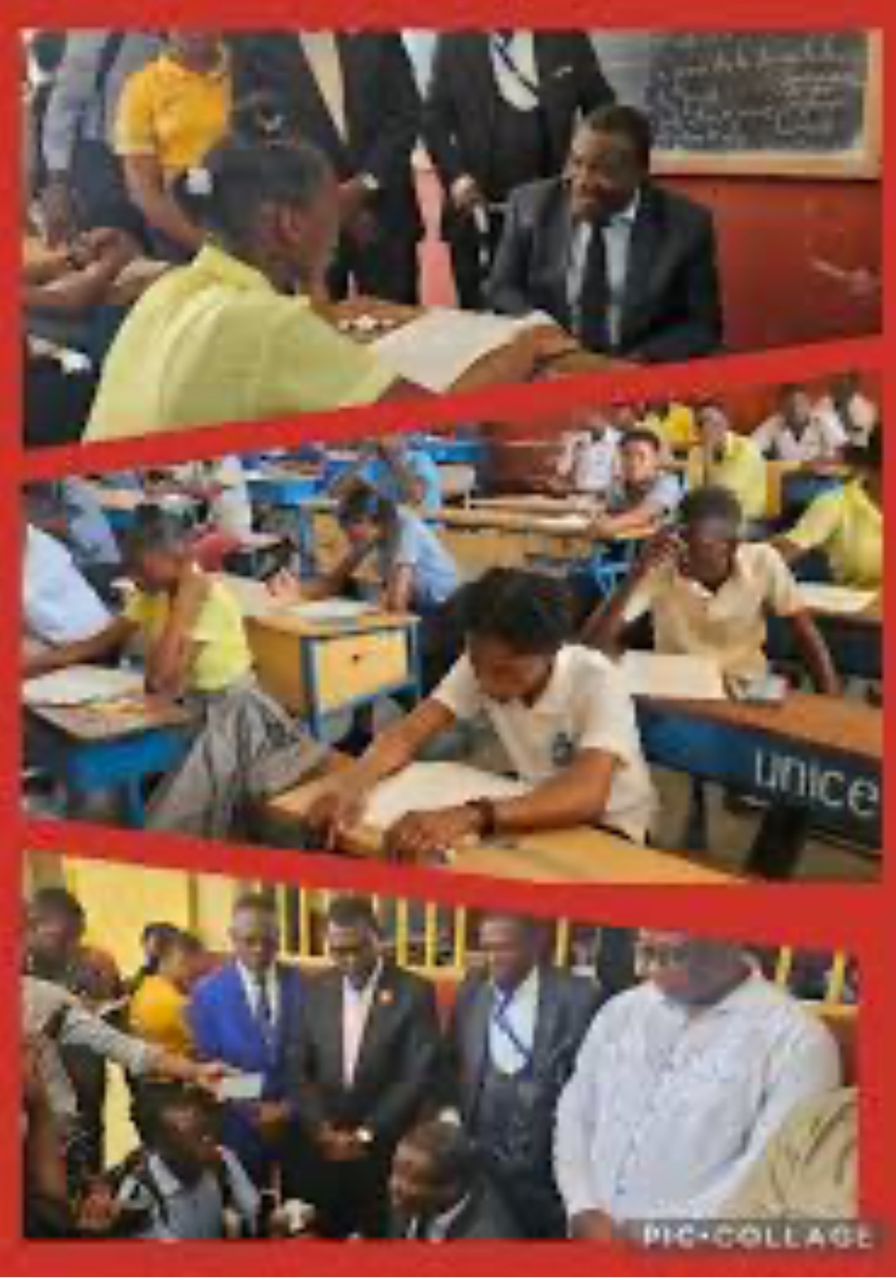Par Jean Wesley Pierre
Port-au-Prince, août 2025 — La boucle semble une fois de plus bouclée. Après avoir été chassés, brutalisés, dépossédés et réduits à l’errance dans des camps improvisés, des centaines de familles de Solino, de Nazon, de Delmas 30 et d’autres quartiers reviennent dans leurs anciennes demeures. Mais ce retour, loin de signifier une renaissance, pose davantage de questions qu’il n’offre de réponses.
Garanties offertes par les gangs
Aucune garantie sérieuse n’a été donnée. Jimmy Chérisier, alias Barbecue, celui-là même qui a semé la terreur, invite, aujourd’hui, les habitants à réintégrer leurs maisons. En réalité, rien n’empêche que les violences se répètent. L’ancien ministre Edwin Paraison, responsable de la fondation Zile, se dit préoccuper par la situation; il voit dans cet appel une manœuvre stratégique.
« Recherche de légitimité, usage cynique des civils comme boucliers humains, et préparation à d’éventuelles négociations politiques ». En clair, la « garantie » ne vient pas d’un État de droit, mais de la parole d’un chef criminel — parole fragile, volatile, toujours réversible.
Une cohabitation possible entre civils et gangs ?
La question paraît presque absurde. Cohabiter signifierait vivre ensemble dans un espace partagé où chacun respecte des règles communes. Or, les gangs imposent leur loi par la violence, rackettent, violent, tuent. Les habitants, eux, sont réduits à la survie. Ashley Laraque, porte parole de l’association des militaires d’Haiti, souligne avec justesse : « Jimmy Chérisier se positionne comme un interlocuteur, mais il n’y a aucune discussion sur comment réparer les pertes subies par la population. » Sans justice, sans réparation, sans sécurité, il ne peut y avoir cohabitation, seulement une soumission tacite des victimes à leurs bourreaux.
Comment cela pourrait-il se faire ?
Si l’État existait réellement dans ces zones, il lui appartiendrait d’imposer l’ordre républicain, de restaurer la police, d’investir dans l’urbanisation et l’aménagement du territoire. Jocelerme Privert pense qu’il faut une action énergique des forces de l’ordre pour « guérir la blessure et éradiquer le mal ». La reconstruction sociale et urbaine est une nécessité : routes accessibles, éclairage public, services de base. Faute de cela, le territoire reste un terrain fertile pour les mafias armées.
Et les victimes dans tout cela ?
Ce sont elles les grandes oubliées. Comme des brebis égarées, elles retrouvent leurs maisons calcinées, leurs papiers d’identité disparus, leurs petits commerces détruits. Le traumatisme psychologique est immense. Comment guérir ces plaies ouvertes ?
De visu, ces familles arpentent les espaces pour constater l’étendue de leurs pertes. Le constat est effrayant : documents d’identité, petits commerces incendiés, souvenirs évaporés…. Devant ces scènes tristes et douloureuses, le choc de se remémorer les souvenirs et l’incertitude de l’avenir rend perplexe engendrant de questions restées sans réponse pour le moment.
Le militant engagé, l’agronome Marcel Pierre Mondesir sent une espèce de négociation comme une entente secrète entre le pouvoir et les bandits pour permettre ce retour. Il se demande quelles garanties réelles ont les habitants que les bandits ne vont pas recommencer leur forfait? Ainsi quels accompagnements pour la reconstruction à la fois physique et psychologique pour ce retour ?
Debut de l’état de droit
La justice devrait être le premier pas : juger les bourreaux, reconnaître officiellement les crimes. Ensuite, vient la réparation : compensation pour les pertes matérielles, accompagnement psychologique, relogement digne. Sans cela, les victimes resteront prisonnières d’un cycle d’humiliation et de misère.
En Haïti, chaque retour forcé des déplacés ressemble à un mauvais remake : les criminels jouissent de l’impunité, les politiques se taisent ou profitent, et la population est livrée à elle-même. Tant que l’État restera absent, tant que les victimes ne seront ni reconnues ni réparées, aucune paix durable ne pourra s’installer. Plus qu’un retour à la maison, c’est un retour à la fragilité, au risque et à l’incertitude. La boucle, une fois encore, est bouclée.