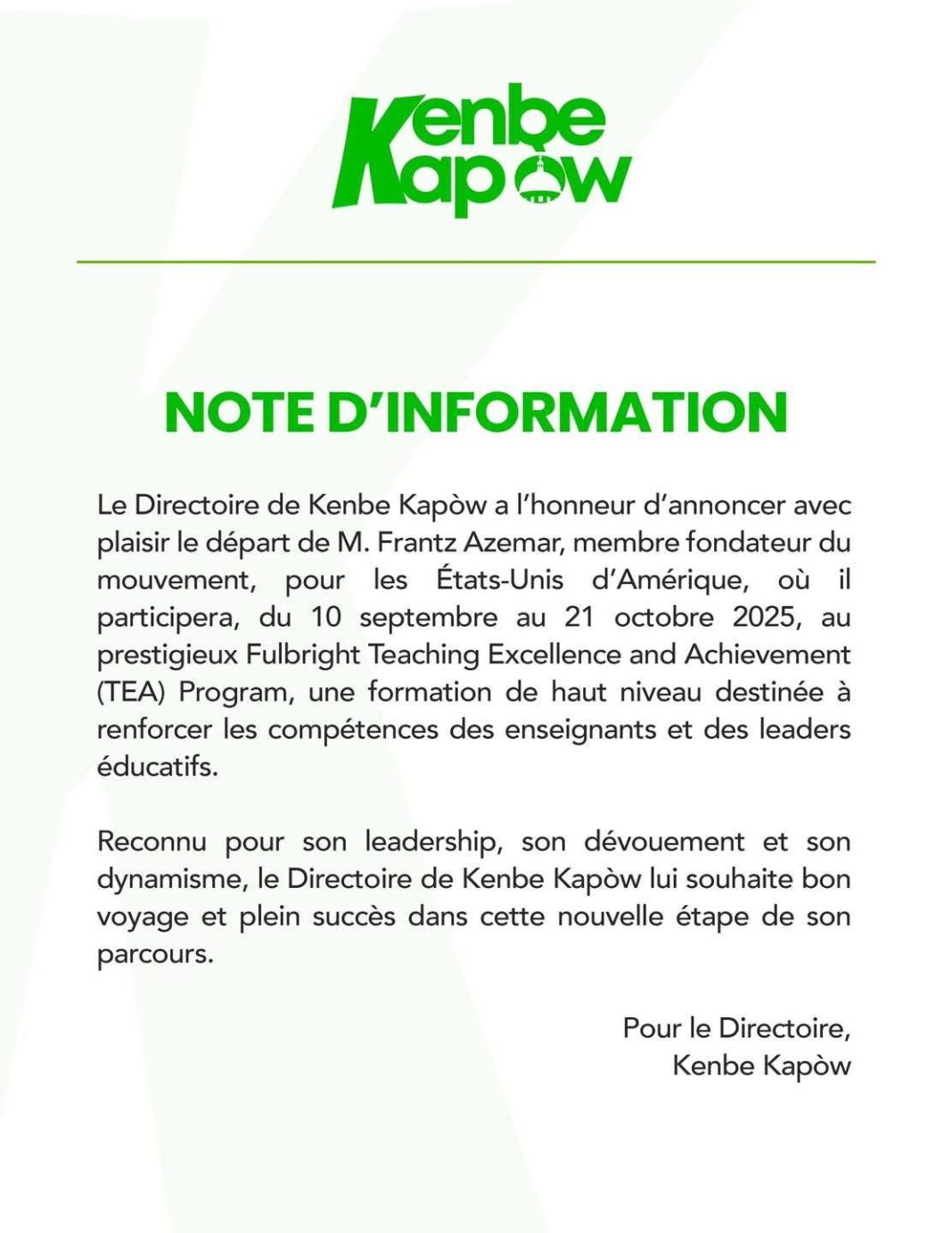Par Pierre Josué Agénor Cadet
Le 11 septembre 1988, l’eglise Saint Jean-Bosco, bastion du prêtre Jean- Bertrand Aristide qui attirait la foule par sa prédilection fondée sur la theologie de libération et la décolonialité, fut le théâtre d’un massacre perpétré en pleine celebration eucharistique par des hommes armés portant des brassards rouges. Cet événement représente l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire contemporaine d’Haïti. Cet acte de violence, survenu dans un contexte de répression politique, a marqué durablement la mémoire collective du pays. L’analyse de cet événement permet de comprendre les dynamiques de pouvoir, de violence et de résistance qui ont façonné la société haïtienne à la fin du XXe siècle.
À la fin des années 1980, Haïti était plongé dans une instabilité politique profonde. Le régime de Jean-Claude Duvalier, dit « Baby Doc », avait été renversé le 7 février 1986, mais les structures de pouvoir issues de la dictature demeuraient influentes. Des groupes paramilitaires, tels que les Tontons Macoutes, continuaient d’exercer une violence systématique contre les partisans du changement et de la démocratie. Dans ce contexte, l’église Saint-Jean Bosco, dirigée par le prêtre Jean-Bertrand Aristide, était devenue un lieu de résistance populaire, prônant la justice sociale et les droits des opprimés.
Le 11 septembre 1988, alors que plusieurs centaines de personnes assistaient à la messe dominicale, l’église Saint-Jean Bosco fut attaquée par des malfrats à la solde du régime putschiste . L’attaque dura environ trois heures, durant lesquelles l’église fut incendiée, rendant impossible la vérification du nombre exact de victimes. Les autorités, notamment la police et l’armée, restèrent inactives, laissant les assaillants opérer en toute impunité. Le lendemain, six individus apparurent à la télévision nationale, avouant leur participation au massacre et menaçant de nouvelles violences à l’encontre de toute célébration dirigée par Aristide.
Le massacre de Saint-Jean Bosco s’inscrit dans une logique de répression politique visant à éliminer toute forme d’opposition au régime macouto-duvaliériste en place. Des personnalités politiques, telles que le maire de Port-au-Prince, Franck Romain, ancien membre des Tontons Macoutes, furent accusées d’être impliquées dans l’organisation de l’attaque. Malgré les témoignages et les dénonciations, aucune action judiciaire significative ne fut entreprise, illustrant la persistance de l’impunité au sein des institutions haïtiennes.
Le massacre eut des répercussions profondes sur la société haïtienne. Il renforça la détermination des mouvements populaires à lutter pour la justice sociale, tout en exposant la vulnérabilité des institutions démocratiques face aux forces réactionnaires. L’événement contribua également à la montée en puissance de Jean-Bertrand Aristide, qui, après avoir survécu à l’attaque, devint une figure emblématique de la résistance et fut élu président le 16 décembre 1990
Les survivants du massacre de Saint-Jean Bosco ont joué un rôle crucial dans la préservation de la mémoire de cet événement. Leurs témoignages ont permis de documenter les atrocités commises et de dénoncer l’impunité des responsables. Par exemple, lors du 35e anniversaire du massacre en 2023, un survivant a partagé son expérience, soulignant l’horreur de l’attaque et l’importance de la justice pour les victimes.
Trente-sept ans après le massacre, la mémoire de cet événement reste vive en Haïti. Des commémorations ont lieu ptesque chaque année, rendant hommage aux victimes et rappelant les luttes pour la justice et la dignité. Cependant, la question de l’impunité demeure centrale, car peu de responsables ont été traduits en justice, et les blessures sociales restent ouvertes.
Le massacre de Saint-Jean Bosco demeure un symbole puissant de la lutte pour la justice sociale en Haïti. Il illustre les tensions entre les aspirations démocratiques du peuple haïtien et les forces conservatrices déterminées à maintenir le statu quo. Trente-sept ans après, cet événement commence déjà à s’effacer de la mémoire alors qu’il devrait porter tous les Haïtiens à poser la question de la réconciliation nationale et de la justice transitionnelle en Haïti.
Pierre Josué Agénor Cadet